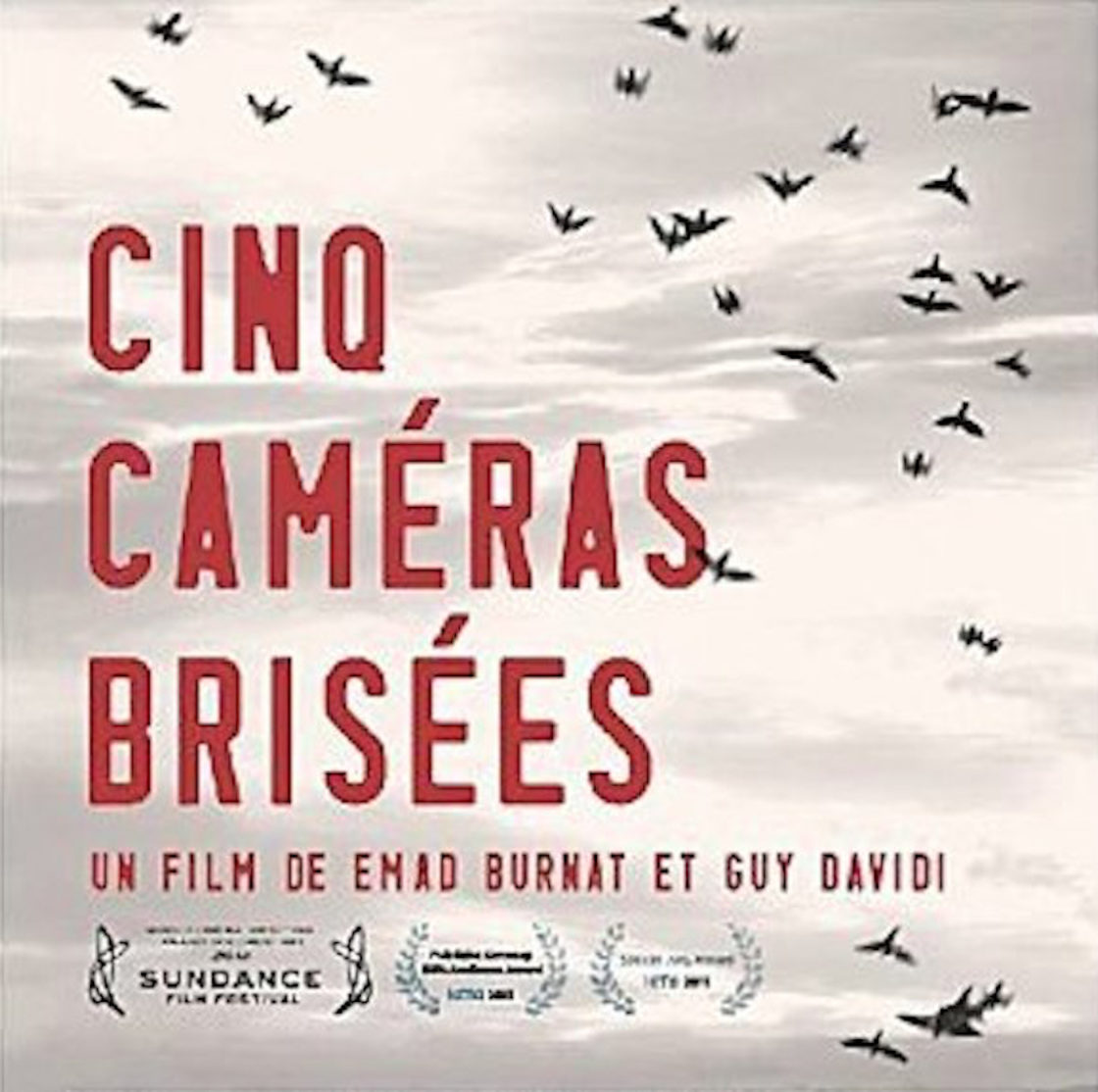Cinq caméras brisées, film autobiographique documentaire, témoigne de la vie quotidienne à Bil’in, un village de Cisjordanie de quelque 1 500 habitants situé à l’ouest de Ramallah, à proximité immédiate d’une des plus grandes colonies des territoires occupés, Modi’in Ilit, qui a aujourd’hui le statut de ville et abrite plus de 80 000 colons. Emad, qui est né sur place et y a toujours vécu, et Soraya, Palestinienne élevée au Brésil mais installée en Cisjordanie avec son époux, vivent de la terre, comme la plupart des habitants de Bil’in. Ils ont trois enfants, Mohamad, Yasine et Taki-Yidin.
À l’occasion de la naissance de leur quatrième fils Djibril en 2005, Emad achète sa première caméra. C’est aussi le moment où les environs du village sont envahis par des géomètres, puis des engins de chantier qui arrachent les oliviers pour construire un mur de séparation, d’abord une simple clôture, qui sépare les habitants de 230 hectares de leurs terres. Il s’agit de protéger la colonie de Mod’in Ilit des éventuels attentats. Le film relate donc la lutte pacifique des paysans pour défendre et récupérer leurs terres. Ils sont épaulés dans ce combat par des Israéliens opposés à l’occupation, principalement des Anarchistes contre le mur, et des activistes venus du monde entier.
Au début, la caméra devait accompagner le petit Djibril dans sa découverte de la vie. Comme c’est la seule, Emad devient rapidement le cinéaste du village. Il commence par filmer sa famille et les fêtes, ainsi que ses deux plus chers amis : Bassem, adoré des enfants qui l’appellent Phil, l’éléphant, toujours optimiste et confiant quoi qu’il arrive, et l’infatigable Adib.
La terre et l’histoire sont profondément ancrées dans la chair même de ces villageois. Comme le dit Emad, aucun de ses enfants n’a eu la même vie. Mohamad, son premier fils, est né en 1995, au moment des accords d’Oslo, une période d’espoir où ils avaient encore la possibilité d’aller à la mer se baigner. Yasine, en 98, est venu au monde dans une période d’incertitude, où il semblait que la fenêtre ouverte était en passe de se refermer.
Taki-Yedin, en 2000, est né le premier jour de la deuxième intifada. Et le dernier petit bonhomme, Djibril, voit donc le jour en 2005, en même temps que le mur coupe les terres de son village en deux.
Les manifestations pacifiques et déterminées se succèdent, mettant rapidement les villageois et leurs soutiens face à l’armée israélienne, qui à son habitude ne fait pas dans la dentelle avec les civils. En automne, c’est la récolte des olives, et les paysans franchissent la zone, mais l’armée palestinienne les oblige à faire un détour considérable. Ils s’opposent, et le frère d’Emad est arrêté par ce qui s’avère être de faux soldats, mais un vrai commando israélien. Les villageois, secondés par leurs soutiens israéliens, commencent à manifester tous les vendredis pour essayer de rejoindre leurs terres. La lutte juridique est prise en charge par ces derniers.
Les confrontations avec l’armée, qui les empêche d’aller aux olives, deviennent constantes. Au fur et à mesure que le mur s’érige, des activistes chevronnés venus du monde entier s’y enchaînent pour empêcher l’avancement des travaux.
L’armée réagit brutalement, et une grenade lacrymogène brise la première caméra, blessant Emad à la main. Elle aura filmé de l’hiver à l’automne 2005.
Chaque fois la lutte paie, mais elle paie chichement : la mobilisation a entraîné une autorisation provisoire d’aller aux champs. Il est assez déchirant de voir le petit Djibril prononcer ses premiers mots en suivant ses parents vers leurs terres : « mur », « cartouche ». Pour les villageois, qui n’ont d’autre revenu que leurs récoltes et leurs bêtes, cette autorisation est littéralement un ballon d’oxygène. Comme toujours, ils y vont en groupe d’hommes, de femmes et d’enfants. En réponse aux caravanes illégales qu’installent les colons en avant-postes, les villageois installent deux caravanes successives, qui sont enlevées, puis un avant-poste en dur, qui ne sera jamais abandonné.
Les manifestations internationales au moment de l’attaque du Liban sont férocement réprimées par l’armée, qui tire à balles réelles sur les manifestants.
Et le film continue, illustrant le combat désespéré de David contre Goliath, de la force contre le droit. La terre est défoncée par les bulldozers, les oliviers incendiés en représailles par les colons.
Ce qu’on voit aussi, d’un point de vue global, c’est comme en maints endroits du monde une petite paysannerie être dévastée et ses terres détruites par des machines que protègent des soldats, pour que s’érigent des bâtiments coupés de tout lien à la terre, que se multiplient les routes qui morcellent inexorablement le territoire. Dans une image du début, quand arrivent les premiers bulls, on voit un chevreuil s’enfuir dans une course désordonnée. Reconstruire sans fin ce qui est détruit sans fin, replanter ce qui a été incendié, et à chaque fois perdre inexorablement du terrain. La terre est défigurée, le corps même du cinéaste est de plus en plus abîmé au fur et à mesure que s’enchaînent les épisodes de sa vie, que Soraya éreintée le supplie de s’arrêter, bien qu’elle ait été partie prenante du combat et l’ait soutenu depuis le début -mais il ne s’arrêtera plus. Les soldats viennent de plus en plus souvent faire des incursions dans le village, pour prévenir les manifestations ils harcèlent la population, en vain. Les enfants ripostent à leurs incursions par des jets de pierres, ils arrêtent les enfants. L’éternelle confrontation des armes lourdes et des pierres continue. Le village est décrété zone militaire. Des enfants sont raflés de nuit et emmenés en prison, certains défenseurs obstinés des terres sont tués, d’autres, dont Emad, ses frères et Adib, sont emprisonnés pour de longues périodes. Le combat juridique porte ses fruits, le mur doit être démantelé. Il le sera deux ans après la décision de justice, rendant au villageois 80 hectares sur les 230 confisqués. Le nouveau mur, en deçà du premier, est en béton. Il n’y aura plus de possibilité d’accès aux terres. Les immeubles s’érigent sur les terres volées. Les manifestations continuent, le mur s’étend vers d’autres villages. Le découragement gagne, sans pourtant empêcher les manifestations de plus en plus nombreuses, puisque nombre de villages concernés s’inspirent de la lutte de Bil’in. Un enfant de 11 ans est tué, puis, juste après les obsèques, un gamin de 17 ans. Il n’est pas aisé de rester pacifiste.
La deuxième caméra, brisée par un colon furieux d’être filmé, aura couvert l’occupation de l’hiver 2006 à l’automne 2007.
La troisième caméra sauve probablement la vie d’Emad, puisque la balle tirée sur lui reste coincée dedans. Elle aura filmé de l’hiver 2007 à l’hiver 2008.
La quatrième est brisée lors d’un accident de camion, elle est brisée avec son propriétaire, gravement blessé. Elle a tourné pendant l’année 2008. Emad est transporté à l’hôpital de Tel-Aviv.
La lutte continue. Rien ne peut décourager les manifestations. Le film s’arrête peu après que la cinquième caméra a été brisée, encore une fois, par une balle. Elle aura duré de l’hiver 2009 au printemps 2010. Elle s’arrête sur une fin ouverte, ouverte sur une impasse : la lutte continue contre le nouveau mur, sur lequel le petit Djibril va écrire son nom. Le film finit pourtant sur les images radieuses de Djibril et Taki-Yidin à la mer, où leur père les emmène quand il va se faire enlever ses points de suture à l’hôpital de Tel-Aviv. La sixième caméra, est-il dit, a suivi le démantèlement du mur au printemps 2010. Emad a été atteint par une grenade assourdissante, mais sa caméra n’a pas été endommagée et elle filme toujours.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Si Emad a déjà projeté les films devant les villageois pour atténuer leur découragement, il n’est pas monteur, c’est un paysan qui filme. Parmi les Israéliens qui avaient coutume de venir en territoire occupé, et particulièrement à Bil’in, il y avait Guy Davidi, réalisateur qui participait aux marches contre le mur et a même résidé trois mois à Bil’in pour un autre tournage. Les deux hommes se connaissaient. Emad voulait faire un film en hommage à Adib, puis à Adib et Phil, quand ce dernier a été tué par un sniper. Mais Guy ne voulait pas que le film soit un hommage aux martyrs de plus. Il a préféré inciter Emad à prendre comme focale sa vie personnelle, une gageure dans cette société très traditionnelle où les hommes occupent l’espace public, tandis que les femmes restent dans les maisons. Il se demandait si le film ne pourrait pas s’articuler autour du dernier-né, Djibrill, qu’en effet on suit de sa naissance à ses cinq ans sur fond de lutte de survie, dans les coups de feu, les manifestations et les rafles. Car si les femmes ne sortent guère, sauf pour aller récolter les olives, les enfants, eux, suivent leurs pères : au début, la petite fille d’Adib l’escorte régulièrement, tandis que les fils d’Emad le suivent pareillement lors des manifestations. Les enfants courent partout. Ils sont ainsi témoins des arrestations et des coups de feu, des blessés et des morts. Comme le dit un Guy choqué qui voulait mettre l’accent sur ces violences, pour Emad elles représentaient une sorte de terrible routine à laquelle il était confronté depuis l’enfance, elles ne l’étonnaient pas.
Les femmes, on ne les voit que peu. Soraya, qui représente un soutien indéfectible au début, finit par être saisie de panique après l’emprisonnement de son époux, puis son accident. C’est elle qui a la charge de la vie et de la survie de cette famille de six personnes, et il est déchirant de la voir peu à peu céder à la peur et l’épuisement. Non qu’elle soit moins brave que son époux, au contraire, dans ces conditions de cauchemar elle assure le quotidien à chaque heure, chaque minute, dans cet héroïsme occulté de toutes les mères pauvres du monde. Les autres femmes du village, celles qu’on voit résister vigoureusement à mains nues aux soldats armés jusqu’aux dents qui tentent de s’introduire dans une maison pour rafler les enfants, celles qu’on voit, circonstance exceptionnelle, manifester ensemble leur joie dans les rues en chantant, la mère d’Emal s’opposant physiquement aux soldats qui embarquent un autre de ses fils, tandis que le père grimpe sur la jeep des soldats pour l’empêcher de repartir, on voit bien que sans d’aussi solides bases arrière aucune résistance n’aurait pu être assurée. Et si ce film est assurément un film d’hommes, on sent la présence vigilante des femmes dans ce quotidien assumé qui leur permet de vouer toutes leurs forces à la lutte. Soraya pourtant, une fois Emad devenu incapable de tout travail physique, le supplie de rester à la maison avec elle et ses enfants, de se trouver d’autres occupations que filmer. Elle redoute, et elle n’a pas tort, que ce combat sans issue finisse par la laisser seule avec ses enfants — bien que seule, dans cette société très conservatrice, elle le soit par vocation, dans l’enfermement domestique, et qu’Emad ne les mesure pas, cette solitude et cet enfermement, lui que ne vit que pour la lutte et ses amis. Mais on subodore aussi que la soumission ne remédierait pas à la logique oppressive de l’occupant, au contraire : la dépossession est le seul programme d’Israël pour les Palestiniens, c’était vrai à l’époque, ça l’est encore plus, malheureusement, aujourd’hui. Et c’est ce qu’au bout du compte on retire de la vision bouleversante de ce film documentaire sans le moindre effet esthétique, un pur film d’amateur, mais où la voix douce et mélancolique d’Emad accompagne les images choquantes de la violence coloniale vue par ceux qui la subissent : deuil, colère, découragement, opiniâtreté, deuil encore, comme le dit Emad au début du film : « Les blessures n’ont pas le temps de guérir que d’autres surviennent. Alors je filme, pour ne pas perdre la mémoire. »
Lonnie
Cinq caméras brisées, film franco-israélo-palestinien d’Emad Burnat et Guy Davidi, 2011