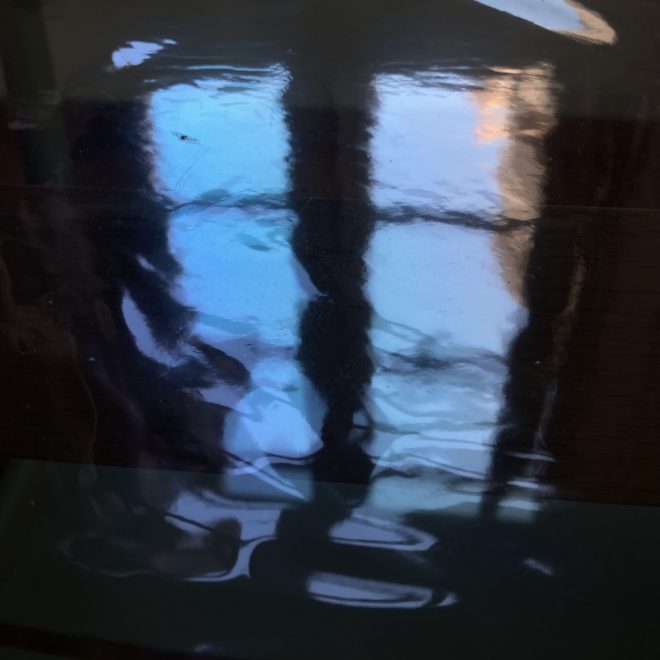De Madeleine Barthes nous ne savons que peu de choses. Elle naquit à Toulouse en 1924 et mourut en 1977 après avoir été enseignante. On pourrait lui donner la biographie souhaitée par Pessoa : entre ces deux dates, tous les jours sont à elle. Et c’est avec une attention contemplative qu’elle exhume, comme s’il s’agissait de vestiges archéologiques extrêmement fragiles, ce qu’ils sont, les souvenirs d’une autre époque. Les époques ne se définissent pas seulement par leur situation temporelle, mais par l’univers sensoriel qui s’y rattache, et dont inexorablement les bribes se perdent jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien. Le recueil est donc divisé en quatre parties, « Les objets. Le nom des lieux », « Les saisons secrètes », « Le refuge », et enfin, arrivant de façon un peu décalée par rapport aux trois premiers, « Notes d’un voyage en Sicile ». Les parties suivent une chronologie qui part de l’enfance avant et pendant la guerre, l’adolescence, la jeunesse et un premier poste, puis le fameux voyage. Tantôt les poèmes prennent une allure d’inventaires précautionneux, si précautionneux qu’ils arrivent à restituer les choses les plus ténues, les plus fragiles, les plus légères. Tantôt on dirait qu’il s’agit de notes jetées sur un coin de papier pour être développées plus tard. D’autres fois ce sont des textes en prose plus diserts, toujours attentifs à n’en pas dire trop mais à dire au plus près de la vérité. On tombe parfois sur des haïkus pour la brièveté, et c’est d’ailleurs tout l’esprit du haïku qui anime le recueil : saisir l’insaisissable, rendre une impression intense en décalant légèrement la focale. Et devient peu à peu réel ce que nous n’avons pas pu connaître, nous, et qui remonte si frais et vivant de l’enfance de Madeleine :
« … L’évier rouge où se lavait le bloc de beurre –
la jonchée – ce goût que je ne retrouverai jamais –
jonchée glissant sur la langue – le sucre qui craquait
sous la dent – la marchande de jonchée –
verte blanche, verte blanche… »
Mais aussi la façon dont le calendrier catholique rythmait encore les années, et tout ce qui revient de ces jalons :
« … les initiales de la vierge
la veilleuse et son odeur de cire
les fleurs blanches de mai
odeur d’aubépine
œillets blancs, parfum à la fois sucré et poivré
avec un je ne sais quoi d’excitant… »
« … le manteau de ratine ou de ce tissu trop lourd
pour mes épaules de neuf ans
les souliers vernis, noirs, qui craquaient, qui serraient,
le bouton si dur à attacher. »
Ces flashes recomposent la lumière d’autrefois, celle d’une enfance de ce temps-là, dans cette ville-là, de cette petite fille-là, « brune et potelée », dans cette famille-là, mais c’est le passé et l’enfance génériques qui montent à la surface sans jamais émerger vraiment. On peut y reconnaître le souvenir parallèle d’autres peupliers, d’un autre canal, d’une autre histoire, d’autres maisons, d’autres grand-mères. La guerre est évoquée par les bruits qu’elle fait et tout ce qu’elle brise. C’est juste l’une des peaux du temps qui se déplie et qui se réverbère, tous les enfants ressentent avant de s’emparer du langage des communications, et l’enseignante, dans les dernières décennies de sa vie, tente de lui redonner, au langage, ce qui est aussi l’une de ses fonctions paradoxales, traduire ce qui ne ressort pas du langage avec des mots en s’en servant comme de couleurs. C’est magnifique et émouvant. Madeleine montre cette part d’enfance symbiotique au monde qui survit dans l’adolescence et jusque dans l’âge adulte. Les saisons secrètes commencent par en brosser un décor encore frémissant, perçu par tous les sens :
« Automne – hiver d’adolescence
la pluie – les feuilles vernissées des chrysanthèmes
leur odeur
la pluie – les feuilles mortes –
tous les tons de roux – collées au sol, engluées
le pain gris
le goût sucré des navets
le froid – l’hiver dans la cuisine
le givre – la vapeur sur les vitres
derrière les rideaux de grosse cotonnade écrue et rouge
la brassée de bois jetée sur le carrelage
la tranche de pain enfilée au bout d’un bâton… »
Cette fois ce sont la solitude et la sensibilité à vif de l’adolescence qui sont délicatement exhumées du souvenir. Puis vient la chronique d’un premier poste dans une institution pour jeunes filles perdues, sorte de prison intitulée le Refuge, et l’inévitable jeu de miroir entre les adolescentes et la jeune enseignante, trop jeune pour ne pas être proche d’elles :
« … la fille aux yeux si clairs
le peigne de celui qu’elle avait aimé
le « traître » fusillé
elle revoyait son cadavre flottant entre deux eaux
l’eau colorée de son sang – le peloton d’exécution
la fille et le bébé qu’elle avait tué peut-être
les « Madeleines » – visages étonnés – naïfs –
marqués – par quoi ?
et les crânes tondus… »
Tout doucement ce long poème s’organise comme un chant répétitif où reviennent toujours, à peine changés, les éléments d’un refrain qui ressemble au déroulement des jours et va se dépouillant, les filles, « fauves en cage », chacune ayant laissé son souvenir, les cachots, les crises, « la blancheur morte des religieuses », les saisons. Mais fidèle à l’enfance encore animale, elle en saisit aussi la matière comme si elle en était prisonnière :
« … les hautes fenêtres – les dalles disjointes – les images saintes
et l’odeur d’encens dans le bureau de « notre mère »
les glissements – les pas feutrés
les fleurs volées – leur odeur – leur couleur
les jours de grand vent
« mazières » – le cachot – les crises
les garçons comme suspendus dans le ciel
le mur – la tentation… »
Les notes d’un voyage en Sicile sont brèves et précises. Elles sont écrites à la deuxième personne du pluriel, bien que les impressions sensorielles renvoient aux poèmes précédents. Madeleine n’est pas seule, nous sommes en août 67, elle a 43 ans. Elle ne sait pas encore que ses deux filles, chérissant son souvenir, feront publier ces notes cinquante ans plus tard, et les émouvants poèmes à travers lesquels elle a essayé non de piéger mais de faire se poser comme un oiseau le passé intemporel, le temps d’un soupir, sur un assemblage léger de mots. De son vivant, elle n’avait jamais pensé les publier. Sans ses filles, nous n’aurions pas pu les lire. Le recueil finit d’ailleurs par la postface de l’une d’entre elles. Qu’elles soient remerciées.
Lonnie
Les saisons secrètes, Madeleine Barthes, ed. Fario, 2020
Photo © Pere Farre