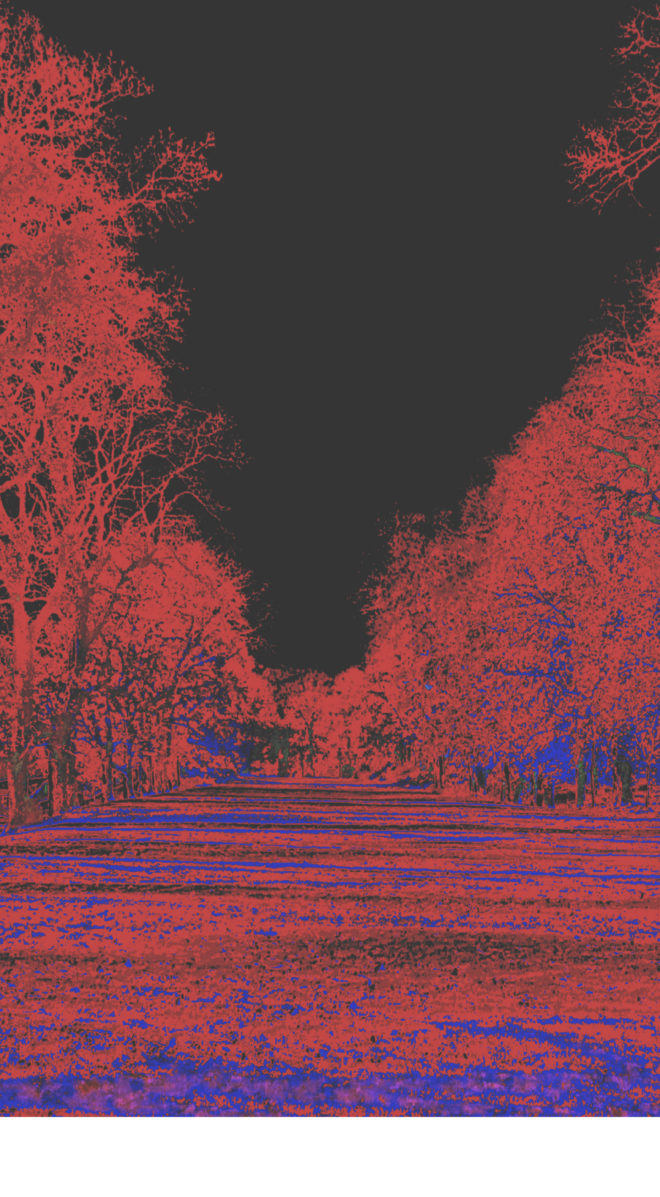Ce récit puissant et parfaitement mené commence à travers le regard de Catherine, la petite sale, une gamine de dix-neuf ans employée comme bonne à tout faire au domaine de Monsieur. Monsieur possède les hectares et les gens, rien dans ce pays où même la boue est plus riche que Catherine ne se fait sans lui. C’est un de ces potentats que la littérature anglo-saxonne n’hésite pas à dénoncer, de ceux qui possèdent les entreprises et les communes, la presse, le personnel politique. La littérature noire anglo-saxonne en a fait ses choux gras, de ces parrains impitoyables, seigneurs modernes d’une société qui ne se reconnaît plus de serfs, si elle se reconnaît des élites. L’argent achète tout, la docilité, le silence, le crime. La littérature noire française, elle, rechigne à dresser des portraits si médiévaux de ce qu’on appelle les notables. Et pourtant.
Catherine promenait la petite-fille de Monsieur, Sylvie, pendant que la mère aux nerfs fragiles prenait un peu de repos. En rentrant de promenade avec la petite, elle est bousculée par un journalier qui s’amuse à tourner autour d’elle avec une brouette, la séparant de l’enfant. Et lorsqu’enfin il se lasse de ce petit jeu, Sylvie n’est plus là. Sylvie a disparu et ne reparaît pas, le drame s’ouvre.
Monsieur, c’est Augustin Demest, qui a épousé le premier domaine, en rouge sur la carte que les deux flics venus se les geler de Paris étudient ensemble en suivant les explications du gendarme Aubreuil. Après guerre, tous les hommes ne sont pas rentrés, ceux qui sont rentrés n’étaient pas toujours en bon état, on ne faisait pas confiance aux femmes. Nombre de fermes en difficulté sont tombées dans l’escarcelle de Demest, premier cercle d’acquisitions, en jaune et vert. Mais surtout, dès cette époque, ce paysan cupide fait le pari de traiter directement avec une coopérative laitière du coin, Lactalis, aux dents longues et qui paie mieux. À l’époque ce n’est pas encore une multinationale, mais elle fait le forcing pour rafler le marché dominé par Bridel, et pose des contrats d’exclusivité. Une fois sa couronne jaune et verte consolidée, Demest revend ses vaches et se lance dans la betterave, traitant de même directement avec des industriels aussi féroces que lui (et là il n’est pas question de Béghin et de Say, sur le point de fusionner à l’époque, longtemps avant Tereos, mais ça pourrait). Le cercle bleu apparaît. Comme l’explique le gendarme Aubreuil aux deux flics urbains frigorifiés : »Demest s’est fait un réseau. De nouveaux industriels, des conquérants. Des gens qui pouvaient proposer de très bonnes conditions, ou au contraire, de très mauvaises à ceux qui contrariaient les plans de Demest. Observez bien ses couronnes, de la rouge à la bleue : c’est le domaine de Demest qui s’étend, c’est tout ce qu’il a accumulé. L’œuvre de sa vie. Toutes ces petites parcelles, qui sont en vert, en jaune, en bleu, avec les noms dessus. Ce sont les noms de ceux auxquels il les a pris, et je n’emploie pas ce mot par hasard. »
Le décor humain est posé. Dès le 14 février 1969 (le premier chapitre commençant le 10 avec la disparition de Sylvie), la focale glisse du point de vue de Catherine, la petite sale, à celui des deux flics rameutés de la capitale, le jeune Gabriel et Dassieux blanchi sous le harnais, pour épauler et compléter les gendarmes locaux. On leur emboîte alors le pas tout le long de leur enquête laborieuse, dans ce pays de taiseux où la haine bridée, la crainte et la méfiance cousent les bouches, en collaboration avec les gendarmes plus locaux mais à qui on n’en confie guère plus.
Une demande de rançon arrive, les choses se précisent.
La densité du tableau fait penser à Pieter Brueghel l’ancien, avec ces paysages ouverts où s’affairent des fourmis humaines. On sent le froid terrible, la neige, et les rapports entre les gens font figure d’éléments intraduisibles du décor : ils sont là, palpables et hermétiques.
Le jeune flic est obsédé par le fantôme hypothétique de la petite fille disparue : « …Gabriel a de nouveau cette vision d’un tout petit corps, très blanc, très mort, la bouche ouverte et gonflée d’une masse sombre, granuleuse, les dents de lait minuscules noyées dans une poussière grasse et noire, la terre, la terre, la terre lourde, riche, omnipotente, et la mort. » C’est un justicier dans l’âme, il a un fervent désir de sauver les faibles, on sent que c’est dans ce désir spasmodique qu’il puise une force qui lui fait défaut. Il est par ailleurs sujet à la violence. Il est fou de sa femme, une Italienne, dont on devine qu’elle a plus de personnalité que lui. Il n’est pas dominateur, il est ouvert, vulnérable, pas très fin, d’une encombrante bonne volonté. Sa morale est moins erratique que son tempérament. Mais il a de bonnes intuitions, il est assez clairvoyant.
Le vieux flic, Dassieux, pourrait être son contraire. Plus classique, classique jusqu’à la caricature, il n’a de cesse de mettre les points sur les i et de signifier au roi Demest, à qui ils doivent d’être là, qu’il ne les commande pas, qu’il ne commande pas à la loi, qu’ils ne sont pas sous sa coupe, eux (même si leurs supérieurs peuvent s’avérer sensibles aux pressions, raison de leur présence). Le vieux flic laisse sa vie filer dans la gorge insatiable de son foutu métier. Il est tenace, il aime bien le jeune flic, il l’aime plus qu’il ne l’estime, suppose-t-on, comme un jeune chien encore trop fou pour qu’on puisse évaluer s’il sera bon à la chasse. Et pourtant Gabriel, malgré ses obsessions, a du flair, davantage que son collègue, mais il met dans son métier plus que ce que son métier lui demande, et pas ce qu’il faudrait qu’il y mette, selon Dassieux.
Petit à petit, une piste s’ébauche, puis se précise. Le style est riche et puissant, il nous installe confortablement dans l’inconfort terrible des deux flics, dans ce pays aux mains de cupides puissants dont la logique est de tout broyer, la terre, les vivants, leurs semblables. Catherine, la petite qui fait sale bien qu’elle ne soit pas sale, fait-elle partie des choses broyées ? En prenant d’elle le titre du roman, en lui donnant les chapitres d’ouverture et de fin, l’autrice donne à ce personnage sans visage que l’enquête occulte ou minimise les clés de ce récit labyrinthique. Dans cette société figée, de nouvelles dominations plus impitoyables encore que par le passé s’installent. La mère de Catherine, Marie, n’a jamais voulu travailler pour l’Empereur Demest, comme les flics l’appellent. Elle s’en est pourtant sortie, ô combien chichement. Catherine, elle, à dix-sept ans, s’est proposée à l’embauche dans sa maison. Au moment où commence le roman, cela fait deux ans qu’elle travaille pour Monsieur. Toutes les fortunes édifiées réclament, pour se constituer, autant de sang que de sueur. Petite sale n’est rien, un fétu.
« Chaque matin et chaque soir, elle quitte les bas-côtés de la route et coupe par le petit bois. C’est son raccourci préféré. C’est à elle. Elle n’a pas grand-chose, mais ça, c’est à elle. Le petit sentier adouci par ses pas, le parfum d’humidité sauvage qui monte du sol, l’odeur du grand seringa qui la chavire aux derniers jours de juin, la fraîcheur qui la désaltère en été et les secrets que murmurent les branches qui craquent en hiver. Si elle avait comme Monsieur la conviction qu’on peut posséder la terre et pas juste la parcourir, elle dirait du petit bois qu’il est à elle. Mais alors qu’elle est dans le bureau de Monsieur ce soir de février glacial, les yeux baissés, occupée à regarder la boue qui macule ses souliers, comme toujours dans ces moments-là le ton sur lequel on lui parle lui rappelle sans l’ombre d’un doute qu’elle ne possède rien. »
L’histoire se déroule, de plus en plus tendue, jusqu’à sa résolution qui s’épanouit comme une fleur inattendue, un printemps. L’enquête et sa résolution partielle auront duré à peine une dizaine de jours, et rien n’aura bougé vraiment dans ce pays cimenté par l’inégalité et la haine. Février le boiteux, dont on dit que c’est le plus petit mais pas le moins méchant, aura écrasé de son froid intense les protagonistes de cette histoire qui révèle tout un monde. On repose le livre enchantée et on s’extirpe de son ambiance à regret, avec la certitude qu’on le relira encore deux ou trois fois, pour le plaisir.
Lonnie
Petite sale, roman, Louise Mey, éditions du Masque, 2023.
Petite sale 2A © Gina Cubeles 2024